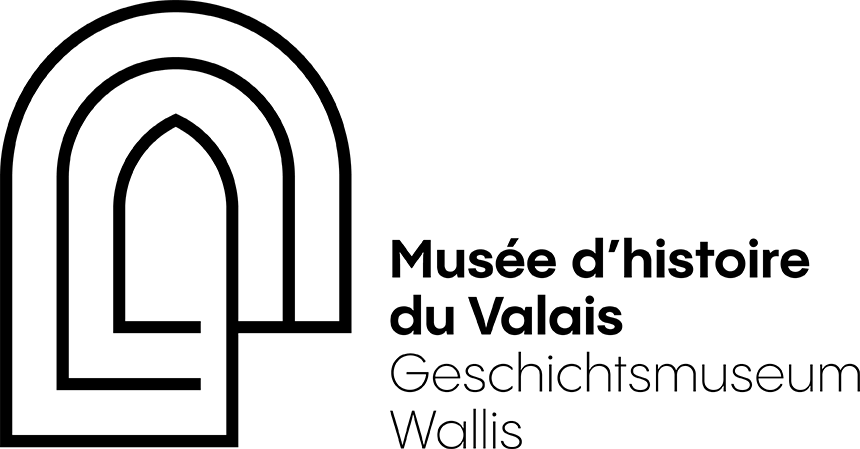Qui sommes-nous ?
Le musée aujourd’hui
Véritable machine à remonter le temps, le Musée d’histoire du Valais vous convie à un voyage de quelque 50’000 ans. Des plus anciennes traces de production humaine, laissées par les Néandertaliens, jusqu’aux témoignages emblématiques de notre époque, découvrez le riche passé du territoire valaisan.
Niché dans le bourg médiéval de Valère, le Musée d’histoire du Valais se déploie dans les anciennes habitations des chanoines qui ont occupé le site dès le 12ᵉ siècle. Réaménagées et regroupées au fil du temps, ces maisons dessinent aujourd’hui un labyrinthe de pièces qui abritent un millier d’objets issus des vastes collections du musée. Parfois rares et uniques au monde, ces témoins de l’aventure humaine racontent l’histoire d’un territoire homogène, bien défini entre de hautes chaînes de montagnes.
Le parcours de visite adopte un regard chronologique et met en avant des thématiques fortes pour chaque époque, de la Préhistoire à nos jours, passant par l’Âge du bronze, l’époque romaine ou encore le Moyen Âge. Au fil des salles, ce voyage dans le temps donne aux visiteuses et visiteurs des clés permettant de comprendre le Valais d’aujourd’hui.
Notre histoire
Avant 1879 : l’époque des pionniers
En 1829, le père jésuite Étienne Elaerts (1795-1853), professeur au collège de Sion, réorganise le Cabinet de physique de l’institution et lui adjoint un Cabinet d’histoire naturelle. Très vite, il tente de collecter aussi quelques «antiquités» dont il déplore la vente à vil prix à des antiquaires. L’État soutient rapidement ce «Musée cantonal». Au milieu du 19ᵉ siècle, des voix s’élèvent à nouveau contre la disparition du patrimoine du Valais, tant en termes d’objets vendus qu’en destruction de monuments pour en récupérer les matériaux. Par la loi du 31 mai 1849, le contrôle du musée et de la bibliothèque du lycée-collège passe en mains de l’État qui pourvoit à leur entretien et à leur accroissement.
1879-1882 : la «Commission archéologique»
En 1879, une «Commission archéologique» est constituée, officialisée par le Conseil d’État en 1881. Le but clairement affiché est de créer un musée destiné à présenter le patrimoine mobilier du canton. Une circulaire adressée aux communes et paroisses dès 1879 tente de sensibiliser ces dernières au projet par le don d’objets anciens de tous ordres. Du musée cantonal existant sont détachées les pièces historiques, auxquelles s’ajoutent les nouveaux dons et la collection d’armes et armures constituée par le commissaire des guerres Charles de Preux et le conservateur du matériel de guerre Eugène Theiler. Ces deux derniers font partie de la commission, rattachée au Département de l’Instruction publique, aux côtés du chanoine historien Pierre-Antoine Grenat, président, de Pierre-Marie de Riedmatten, professeur au collège et conservateur du Musée cantonal, ainsi que du peintre Raphael Ritz, grand défenseur du patrimoine à la suite de son père Laurent-Justin.
1883 : l’ouverture de la première salle du musée
Par l’entremise du chanoine Grenat, le Chapitre cathédral accepte de mettre à disposition de la commission l’une des grandes salles du bourg fortifié de Valère, ainsi qu’une partie de ses collections. Après quelques travaux de consolidation effectués par l’État du Valais, la première présentation du «Musée archéologique» est inaugurée en 1883. Le Valais s’inscrit ainsi relativement vite dans la mouvance de la création de grands établissements à vocation nationaliste, initiée par les Grisons en 1872, Lucerne et Fribourg en 1873, Berne en 1881. Le Musée national, à Zurich, n’ouvrira ses portes qu’en 1898.
Les collections sont encyclopédiques, mais privilégient la «grande» histoire du Valais, celle des personnages illustres et des familles aristocratiques. L’histoire longue n’est pas oubliée et des fouilles archéologiques sont menées, notamment à Martigny, ancienne capitale de la province romaine, afin de pourvoir la présentation d’objets idoines. C’est en particulier en 1883 que sont découverts les fameux «grands bronzes» de Martigny.
1891 : la convention avec le Chapitre cathédral
Les collections augmentent rapidement. Une convention est signée avec le Chapitre cathédral, d’ailleurs sans fixer de durée, afin d’assurer la mise à disposition de la plupart des bâtiments civils du bourg pour le musée, à condition que ceux-ci soient restaurés par l’État du Valais. Le Chapitre s’engage de plus à maintenir dans l’église de Valère les objets d’art qui s’y trouvent.
1893 : la séparation du «Médaillier cantonal»
Afin de gagner de la place à Valère, le Médaillier cantonal est détaché du Musée archéologique et installé dans une salle du collège. Le chanoine Grenat en devient officiellement conservateur. Il s’occupait déjà des collections numismatiques depuis 1891, laissant à Charles de Preux la direction du Musée archéologique. Charles de Rivaz lui succède au Médaillier en 1901 et fonctionne jusqu’à son décès en 1914, la fonction étant alors reprise par le directeur du musée.
1896 : l’arrêté concernant le «Musée archéologique et numismatique»
Le Conseil d’État précise le fonctionnement du «Musée archéologique et numismatique» dans un arrêté établi le 17 juin 1896. L’institution est supervisée par la Commission archéologique, présidée par le chef du DIP. Cette dernière veille à l’augmentation des collections, notamment par un crédit octroyé par le Grand Conseil. Le tarif d’entrée est aussi indiqué, soit 50 centimes par personne seule, 1 franc pour un groupe de 3 à 6 personnes, 2 francs pour groupe plus important. Le musée est ouvert le premier jeudi de chaque mois, de 14h00 à 17h00.
Fin du 19ᵉ siècle : une augmentation exponentielle des collections
Les rapports annuels relatent régulièrement le manque de place pour exposer l’entier des collections. En plus des pièces données par les paroisses ou par certains particuliers, de plus grands ensembles parviennent au Musée archéologique. En 1890, le genevois Ernest Griolet, souvent en villégiature dans le val d’Anniviers, lègue sa collection qui compte plusieurs centaines de monnaies et d’antiques. En 1896, Charles Fama, directeur du Casino de Saxon, lègue une importante collection de monnaies et médailles comptant près de 5’000 pièces, ainsi que la bibliothèque correspondante. Le petit catalogue du «Musée archéologique cantonal», publié en 1900, dénombre 1’095 objets, sans compter les collections numismatiques.
Début du 20ᵉ siècle : une répartition entre histoire et archéologie
La restauration d’un nouveau bâtiment sur le site de Valère, inauguré en 1904, permet de dissocier la présentation des collections historiques et des objets archéologiques. En janvier de la même année est constitué à Savièse le comité de la Société des Traditions valaisannes, fondée en octobre 1903, qui se fixe comme but de collecter les objets de la vie domestique, afin de doter le musée de ce nouveau pan de collection. Le président est Alphonse de Kalbermatten, architecte responsable des travaux à Valère, le vice-président le peintre Raphy Dallèves et le secrétaire, le peintre Ernest Biéler. Au décès du directeur, Charles de Preux, en 1905, un intérim est assuré par Henri de Preux jusqu’à la nomination en 1906 de l’architecte Joseph de Kalbermatten (1840-1920), puis en 1908 de son fils Alphonse (1870-1960).
1906 : la loi sur la conservation des objets d’art et des monuments historiques
Par la loi sur la conservation des objets d’art et des monuments historiques, promulguée le 28 novembre 1906, la commission archéologique est dissoute et remplacée par une «Commission des monuments historiques» qui élargit son champ d’action aux monuments, en plus du Musée archéologique et du Médaillier cantonal. Le président de cette nouvelle entité est le chef du DIP Joseph Burgener, le vice-président Joseph de Kalbermatten (auquel succède son fils Alphonse en 1908) et le secrétaire, le peintre Joseph Morand. En 1908, Alphonse de Kalbermatten remplace son père Joseph. Durant un temps, il cumule cette fonction avec la direction du musée, le suivi de la restauration du site et la présidence de la Société des Traditions populaires.
1913 : un nouveau règlement
En janvier 1913 est promulgué le règlement spécial pour la police intérieure du château et du «Musée historique de Valère». Ce texte règle les obligations du gardien, les heures d’ouverture, etc.
1917 : la création du poste d’archéologue cantonal
Sous l’impulsion de Joseph Morand, un poste d’archéologue cantonal est créé en 1917, reléguant la Commission des monuments historiques à un rôle consultatif. Morand est nommé à ce poste qui englobe aussi la fonction de conservateur du Musée historique et du Médaillier. Un nouveau bâtiment de Valère est restauré et affecté au musée, peut-être pour les objets de la Société des Traditions populaires, mais les archives restent peu précises à ce sujet.
1932-1935 : des suppressions de postes
Joseph Morand décède en 1932. Pierre Courthion, critique d’art et directeur de la Cité universitaire suisse à Paris, lui succède, mais n’accepte le poste qu’à temps partiel, soit deux mois par année. En 1935, à des fins d’économie, le poste est finalement rattaché à celui d’archiviste cantonal, alors occupé par André Donnet. Durant ces années de disette, le travail sur les collections n’a pas pu se faire de manière optimale et les inventaires notamment en ont largement souffert.
Les années 1940 : vers un renouveau
Dès la fin de la guerre, les services culturels sont réorganisés et de nouveaux moyens leur sont affectés. L’archéologue Pierre Bouffard est mandaté autour de 1945 pour réorganiser les collections archéologiques de ce qu’on nomme alors communément «Le Musée de Valère». En 1944, le peintre Albert de Wolff est nommé conservateur de ce dernier avec pour mission spécifique la création d’un Musée des Beaux-Arts au château de la Majorie. Il œuvre d’abord à temps partiel, avec une fonction d’adjoint de l’archiviste cantonal, puis avec une charge de cours de dessin au collège, avant de pouvoir se consacrer entièrement aux musées. Pour la nouvelle institution muséale qu’il doit créer, de Wolff sort des inventaires du Musée de Valère les œuvres d’art nécessaires à constituer une collection représentative. Le Musée des Beaux-Arts est inauguré en 1947.
1963 : un nouveau bâtiment pour les collections ethnographiques
Après une profonde restauration plusieurs fois repoussée, un nouveau bâtiment de Valère, autour de la salle de la Caminata, peut être ouvert au public. C’est l’occasion pour de Wolff d’y présenter les collections ethnographiques régionales, dont la collecte s’est professionnalisée après-guerre. La nouvelle présentation par discipline et non chronologique, plus épurée aussi, rompt avec la muséographie encyclopédique antérieure.
Les années 1970 : la création de nouveaux musées
De Wolff profite des occasions qui lui sont offertes pour créer de nouveaux musées. Le Conseil d’État lui demande d’installer un Musée militaire cantonal au château de Saint-Maurice pour lequel on cherchait une affectation ; c’est chose faite en 1974. En 1976 déjà, suite aux importantes découvertes effectuées sur le site du Petit-Chasseur, dont les fameuses stèles néolithiques anthropomorphes, et à la donation d’une collection d’antiquités méditerranéennes et proche-orientales par le collectionneur Édouard Guigoz, le Musée d’archéologie s’ouvre dans l’espace de la Grange-à-l’Évêque. L’année suivante, le Musée gallo-romain d’Octodure, antenne du Musée d’archéologie, est installé à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. À chaque fois, les collections du «Musée de Valère» sont amputées des pièces nécessaires aux nouvelles institutions. Le décès accidentel d’Albert de Wolff en janvier 1978 stoppe cet élan.
1978-1984 : la reprise du travail de fonds
Durant son intérim entre 1978 et 1984, l’ethnologue Rose-Claire Schüle s’attache plus particulièrement à un travail harassant de contrôle et d’inventaire des fonds. Elle promeut en parallèle une vision collaborative en initiant notamment la fondation, en 1981, de l’Association valaisanne des Musées.
1984-2004 : la professionnalisation
Dès son arrivée à la direction des Musées cantonaux du Valais en avril 1984, l’historienne de l’art Marie Claude Morand change le nom de l’institution en «Musée cantonal d’histoire et d’ethnologie», manifestant une claire valorisation du contemporain. L’année suivante est signée une convention entre l’État et le Chapitre cathédral qui garantit au Musée la possibilité de rester sur le site de Valère pour un nouveau demi-siècle, mais l’exposition permanente, quelque peu obsolète, doit être remodelée. À côté de la professionnalisation du personnel, de la nomination de plusieurs scientifiques et des campagnes de conservation des collections démarre alors une longue réflexion pour la refonte du musée. En 2005, Marie Claude Morand propose au Conseil d’État de séparer de sa fonction de directrice générale la fonction de conservateur du Musée d’histoire et d’ethnographie et Patrick Elsig est nommé à ce poste (en 2010 il prend le titre de directeur).
2004-2009 : le regroupement des collections
L’impossibilité d’augmenter le personnel de manière suffisante pousse Marie Claude Morand à opter pour un regroupement des institutions qui passent de six à trois (art, histoire, nature). Les collections du Cabinet de numismatique (nouveau nom du Médaillier cantonal depuis 1989), du Musée militaire et du Musée d’archéologie sont réunies au sein du Musée d’histoire du Valais, dont elles provenaient d’ailleurs originairement. Le Musée militaire, trop peu fréquenté, est fermé en 2004. Le Musée d’archéologie est fermé en 2009, après une dernière exposition temporaire.
2008 : la nouvelle présentation du Musée d’histoire du Valais
Après deux préfigurations qui s’installaient dans une partie des bâtiments de Valère pendant que l’autre était en restauration, la nouvelle présentation permanente est inaugurée le 12 septembre 2008 dans des bâtiments totalement rééquipés techniquement et réaménagés muséographiquement. «Musée cantonal d’histoire» depuis 1998, l’institution porte le nom de «Musée d’histoire du Valais» depuis 2007. La nouvelle exposition propose un parcours chronologique avec une thématique forte pour chaque salle. Se voulant un panorama complet de l’histoire du Valais, elle intègre une forte composante archéologique, destinée à pallier la fermeture du Musée d’archéologie.
2015 : la salle du Trésor
Afin de mettre à l’abri les objets d’art qui ne peuvent rester dans la Basilique de Valère, l’ancienne salle des Archives, dans le bâtiment accolé à l’ouest de l’édifice sacré, est aménagée en lieu d’exposition inauguré en 2015. Toutes les pièces présentées proviennent du site de Valère et rappellent près d’un millénaire de présence du Chapitre cathédral en ces lieux, tout en proposant une large diversité de techniques.
Notre équipe
Patrick ELSIG – Directeur du Musée d’histoire du Valais –
Ursina BALMER – Médiatrice culturelle germanophone –
Diony BETRISEY – Agent d’accueil principal –
Charlotte BLASI – Médiatrice culturelle –
Sophie BROCCARD – Chargée d’inventaire, département Préhistoire et Antiquité –
Camille FONTAN – Conservatrice du département Époques moderne et contemporaine –
Jeannine GARAUDEL – Médiatrice culturelle communicante –
Valentine GIESSER – Collaboratrice scientifique du département Moyen Âge –
Mélanie MARIÉTHOZ – Secrétaire-assistante –
Pierre-Yves NICOD – Conservateur du département Préhistoire et Antiquité –
Nos partenaires
Le Musée d’histoire du Valais remercie tous ses partenaires, culturels ou financiers, passés et présents, pour leur collaboration et leur généreux soutien.
Les Amis
La Société des Amis de Valère
Fondée en 1996, la Société des Amis de Valère a pour but de promouvoir la recherche, la diffusion et l’enrichissement du savoir relatif au site de Valère et aux collections qui sont conservées en ses murs. Ainsi, cette association de droit civil soutient des activités très diverses, qu’il s’agisse du financement de restaurations et d’acquisitions pour le Musée d’histoire du Valais, de travaux de recherche, de conférences ou l’édition de publications.
Ses membres sont régulièrement invités à des visites ou voyages en lien avec Valère ou à des activités sur le site, allant de messes dominicales au nettoyage de la colline de Valère. Au comité sont représentés de droit le Chapitre cathédral de Sion, propriétaire des lieux, le Musée d’histoire du Valais qui y présente son exposition permanente et le Service Immobilier et Patrimoine, responsable de sa restauration et de son entretien.
Pour en savoir plus ou adhérer : Les Amis de Valère
Soutiens et partenariats
Associations professionnelles
Le Musée d’histoire du Valais est membre des associations professionnelles suivantes :
- AVM – Association Valaisanne des Musées
- ICOM Suisse – Conseil international des musées
- VMS / AMS – Association des musées suisses
- Association Les Châteaux Suisses
- Art médiéval dans les Alpes
Partenaires culturels
- Chapitre de la Cathédrale de Sion
- Festival international de l’Orgue de Valère